Transformisme et évolutionnisme
Erasmus Darwin (1773-1802) et Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844)
Citation
« Les animaux qui peuplent notre globe, s'offrent-ils
à nos yeux, tels qu'ils ont été créés
? Ou bien se sont-ils modifiés depuis leur création ?
Les espèces sont-elles immuables ? Ou bien des races, transportées
sous l'influence de circonstances différentes, peuvent-elles, à
la longue, s'écarter du type originel, et constituer, à leur
tour, des races ou espèces distinctes par de nouveaux caractères
? ». »
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
- Connaissances au XIXe siècle
- Transformisme
et évolutionnisme
- Question de sémantique
- Antiquité
- Moyen Age musulman
- Avant Darwin
- Charles
Darwin (1809-1882)
- Charles Darwin à Shrewsbury (1809-1825)
- Charles Darwin à Edimbourg (1825-1828)
- Charles Darwin à Cambridge (1828-1831)
- Voyage de Darwin sur le Beagle (27 décembre 1831- 2 octobre 1836)
- Charles Darwin avant la parution de l'Origine des Espèces (1836-1859)
- Charles Darwin après la parution de l'Origine des Espèces (1859-1882)
- Théorie de l'évolution
- Questions de races
- Darwin et la religion
- L'évolutionnisme après Darwin
- Classification phylogénétique et systématique génétique
Pour comprendre le courant évolutionniste, il nous faut
tout d'abord envisager les forces en présence lorsque Charles
Darwin (1809-1882) fit paraître, en 1859, le « maudit
livre » qui l'a « presque tué
» : " l'Origine des Espèces " (![]() infos).
infos).
A cette époque, deux grands courants s'opposent :
- le fixisme (
 infos) qui était de loin le plus répandu,
infos) qui était de loin le plus répandu, - le transformisme qui commençait à prendre de l'importance, bien que fortement minoritaire.
![]()
Le courant évolutionniste (![]() infos), déjà apparu avant Aristote
(382-324 av. JC) et issu de l'approche zoologique (du grec zôon, animal,
et logos science), après la florissant Moyen Age musulman
(
infos), déjà apparu avant Aristote
(382-324 av. JC) et issu de l'approche zoologique (du grec zôon, animal,
et logos science), après la florissant Moyen Age musulman
(![]() infos), se développe au XVIIIe siècle.
infos), se développe au XVIIIe siècle.
Le XVIIIe siècle voit naître les pionniers et les premières classifications de l'Histoire Naturelle. Ce sont des personnages comme :
- René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) ;
- Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) ;
- Charles Georges Leroy (1723-1789) ;
- Erasmus Darwin (1773-1802) ;
- Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) qui constitueront le prélude aux théories évolutives développées par Darwin. Son fils, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), a défini le terme d'éthologie dans son acception moderne, c'est-à-dire l'étude scientifique du comportement des animaux dans leur milieu naturel ;
- Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829).
Erasmus Darwin (1773-1802)
 Erasmus
Darwin (1773-1802) était le grand-père paternel de Charles
Darwin. Il était médecin, poète et philosophe.
Erasmus
Darwin (1773-1802) était le grand-père paternel de Charles
Darwin. Il était médecin, poète et philosophe.
Son ouvrage le plus célèbre
est la " Zoonomie, ou lois de la vie organique " paru en
1794-1796 (![]() infos). Il décrit une ébauche de transformisme qui en
fait un des précurseurs de Lamarck
(1744-1829).
infos). Il décrit une ébauche de transformisme qui en
fait un des précurseurs de Lamarck
(1744-1829).
« Les trois grands objets des désirs qui ont changé les formes d’un grand nombre d’animaux, par leurs exertions pour les satisfaire, sont ceux de la concupiscence, de la faim, et de leur conservation.
- Un grand besoin d’une partie du règne animal a consisté dans le désir de la possession exclusive des femelles… Le but que semble s’être proposé la nature en établissant ce conflit entre les mâles, est que l’animal le plus fort et le plus actif soit employé à perpétuer l’espèce qui, par ce moyen, doit se perfectionner…
- Un autre grand besoin consiste dans les moyens de se procurer la nourriture, et c’est ce qui a diversifié les formes de toutes les espèces d’animaux… Tous ces moyens paraissent avoir été acquis graduellement pendant une longue suite de générations, par les efforts continuels de ces animaux pour se procurer leur nourriture, et avoir été transmis à leurs descendans avec une amélioration constante de ces parties à l’effet d’atteindre le but désiré.
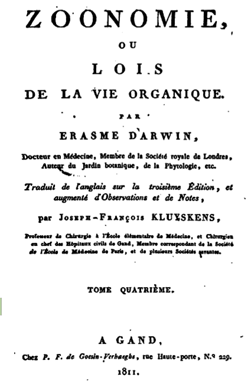 Un
dernier besoin impérieux parmi les animaux, c’est celui de
leur conservation, ce qui paraît avoir beaucoup diversifié
les formes et les couleurs de leurs corps ; ces propriétés
leur donnent les moyens de se soustraire aux poursuites d’autres
animaux plus puissans qu’eux : c’est ainsi que plusieurs ont
acquis des aîles au lieu de jambes pour pouvoir s’échapper
; tels sont les oiseaux de la petite espèce. D’autres ont
des nageoires ou de longues membranes, tels que le poisson volant et la
chauve-souris ; d’autres sont agiles à la course, comme le
lièvre ; et d’autres ont acquis des écailles dures
ou armées, tels que les tortues et l’échinus marinus…
Un
dernier besoin impérieux parmi les animaux, c’est celui de
leur conservation, ce qui paraît avoir beaucoup diversifié
les formes et les couleurs de leurs corps ; ces propriétés
leur donnent les moyens de se soustraire aux poursuites d’autres
animaux plus puissans qu’eux : c’est ainsi que plusieurs ont
acquis des aîles au lieu de jambes pour pouvoir s’échapper
; tels sont les oiseaux de la petite espèce. D’autres ont
des nageoires ou de longues membranes, tels que le poisson volant et la
chauve-souris ; d’autres sont agiles à la course, comme le
lièvre ; et d’autres ont acquis des écailles dures
ou armées, tels que les tortues et l’échinus marinus…
Tous ces moyens paraissent avoir été formés
par le filament vivant primordial, et être mis en action par les besoins
des animaux qui les possèdent et dont l’existence repose sur
eux… Serait-ce une témérité d’imaginer,
que dans la longue suite de siècles écoulés depuis
la création du monde, peut-être plusieurs millions de siècles
avant l’histoire du genre humain, serait-ce, dis-je, une témérité
d’imaginer que tous les animaux à sang chaud sont provenus
d’un filament vivant que LA GRANDE CAUSE PREMIERE a doué de
l’animalité, avec la faculté d’acquérir
de nouvelles parties accompagnées de nouveaux penchans dirigés
par des irritations, des sensations, des volitions et des associations,
et ainsi possédant la faculté de continuer à se perfectionner
par sa propre activité inhérente, et de transmettre ces perfectionnemens
de génération en génération à sa postérité
et dans les siècles des siècles ? » Zoonomie, extraits volume II (![]() infos)
infos)
Son petit-fils n'est pas tendre avec son grand-père, fervent
partisan de Lamarck
(1744-1829). Charles
Darwin (1809-1882) écrivit dans sa biographie en parlant de ses
théories (![]() infos) :
infos) :
« J'ai écouté dans un silence étonné, et, autant que je puisse en juger, sans aucun effet sur mon esprit. J'avais déjà lu la " Zoonomie " de mon grand-père, dans laquelle on retrouve des points de vue similaires, mais qui n'ont produit aucun effet sur moi. Néanmoins, il est probable que le fait d'entendre ces théories précocement dans mon existence, les ont fait perduré dans mon esprit et ont favorisé leur acceptation sous une forme différente, dans mon Origine des espèces. A cette époque, j'admirais beaucoup " Zoonomie ", mais à la deuxième lecture, dix à quinze ans plus tard, j'ai été beaucoup déçu, la proportion de spéculation étant trop grande par rapport aux faits. »
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844)
 Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) a découvert la loi de l'Unité
de la composition organique décrite pour la première fois
dans l’Histoire des makis ou singes de Madagascar, écrit en
1795.
Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) a découvert la loi de l'Unité
de la composition organique décrite pour la première fois
dans l’Histoire des makis ou singes de Madagascar, écrit en
1795.
Son fils, Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), écrit dans " Vie, travaux
et doctrine scientifiques d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire ",
paru en 1847 (![]() infos) : « Enfin, le Mémoire
sur les Makis va nous fournir pour dernier exemple l'idée elle-même,
au développement de laquelle Geoffroy Saint-Hilaire devait consacrer
une si grande partie de sa vie : l'Unité de composition organique.
Et dans ce Mémoire, composé en 1795, publié au commencement
de 1796, l'idée mère de l'anatomie philosophique se trouve,
non pas seulement pressentie, non pas indiquée, mais formulée
avec une étonnante netteté. La nature, ce sont les
propres expressions de l'auteur, a formé tous les êtres vivants
sur un plan unique, essentiellement le même dans son principe, mais
varié de mille manières dans toutes ses parties accessoires.
Et dans la même classe d'animaux, les formes diverses sous lesquelles
elle s'est plu à faire exister chaque espèce, dérivent
toutes les unes des autres ; il lui suffit de changer quelques-unes
des proportions des organes pour les rendre propres à de nouvelles
fonctions, pour en étendre ou restreindre les usages. Toutes les
différences viennent seulement d'un antre arrangement, d'une autre
complication, d'une modification enfin de ces mêmes organes. »
infos) : « Enfin, le Mémoire
sur les Makis va nous fournir pour dernier exemple l'idée elle-même,
au développement de laquelle Geoffroy Saint-Hilaire devait consacrer
une si grande partie de sa vie : l'Unité de composition organique.
Et dans ce Mémoire, composé en 1795, publié au commencement
de 1796, l'idée mère de l'anatomie philosophique se trouve,
non pas seulement pressentie, non pas indiquée, mais formulée
avec une étonnante netteté. La nature, ce sont les
propres expressions de l'auteur, a formé tous les êtres vivants
sur un plan unique, essentiellement le même dans son principe, mais
varié de mille manières dans toutes ses parties accessoires.
Et dans la même classe d'animaux, les formes diverses sous lesquelles
elle s'est plu à faire exister chaque espèce, dérivent
toutes les unes des autres ; il lui suffit de changer quelques-unes
des proportions des organes pour les rendre propres à de nouvelles
fonctions, pour en étendre ou restreindre les usages. Toutes les
différences viennent seulement d'un antre arrangement, d'une autre
complication, d'une modification enfin de ces mêmes organes. »
![]()
C'est Isidore, au milieu du XIXe, définit le terme d'éthologie,
c'est-à-dire l'étude scientifique du comportement des animaux
dans leur milieu naturel, déjà préconisée par
Charles
Georges Leroy (1723-1789) au siècle précédent.
On retrouve dans le texte de son fils
Isidore (à partir de la page 305) la fameuse querelle d'Etienne Geoffroy
Saint-Hilaire contre Georges
Cuvier (1769-1832) en 1830, devant l'Académie des Sciences, de
laquelle ce dernier sortira largement vainqueur (![]() infos).
infos).
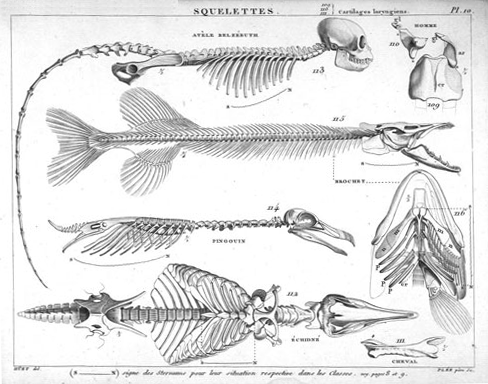 «
On voit que Geoffroy Saint-Hilaire ne se borne pas à réfuter
les systèmes de Cuvier et des finalistes. Il y substitue une autre
doctrine, précisément inverse. Les premiers disaient : La
disposition et la structure d'un organe sont en raison de la fonction qu'il
a à remplir, et, en général, l'organisation d'un animal
en raison de ses moeurs et du rôle qu'il doit jouer dans la nature.
Système que l'on peut résumer dans cette formule souvent reproduite
: Telle est la fonction, tel sera l'organe ; ou dans cette autre, plus claire,
et non moins concise : La fonction est la cause finale de l'organe. Geoffroy
Saint-Hilaire renverse les termes : pour lui la fonction de chaque organe
est en raison de sa disposition et de sa structure, et les moeurs de l'animal
en raison de son organisation; d'où cette formule : Tel est l'organe,
telle sera la fonction; ou bien : La fonction est l'effet de l'organe. Doctrine
qui n'exclut d'ailleurs en rien la réaction de la fonction sur l'organe,
si évidemment apte à se développer, à s'atrophier,
à se modifier, selon qu'il sera plus ou moins et diversement exercé…
«
On voit que Geoffroy Saint-Hilaire ne se borne pas à réfuter
les systèmes de Cuvier et des finalistes. Il y substitue une autre
doctrine, précisément inverse. Les premiers disaient : La
disposition et la structure d'un organe sont en raison de la fonction qu'il
a à remplir, et, en général, l'organisation d'un animal
en raison de ses moeurs et du rôle qu'il doit jouer dans la nature.
Système que l'on peut résumer dans cette formule souvent reproduite
: Telle est la fonction, tel sera l'organe ; ou dans cette autre, plus claire,
et non moins concise : La fonction est la cause finale de l'organe. Geoffroy
Saint-Hilaire renverse les termes : pour lui la fonction de chaque organe
est en raison de sa disposition et de sa structure, et les moeurs de l'animal
en raison de son organisation; d'où cette formule : Tel est l'organe,
telle sera la fonction; ou bien : La fonction est l'effet de l'organe. Doctrine
qui n'exclut d'ailleurs en rien la réaction de la fonction sur l'organe,
si évidemment apte à se développer, à s'atrophier,
à se modifier, selon qu'il sera plus ou moins et diversement exercé…
Essayons de réduire la question à des termes simples.
Les animaux qui peuplent notre globe, s'offrent-ils à nos yeux, tels
qu'ils ont été créés ? ou bien se sont-ils modifiés
depuis leur création ? Les espèces sont-elles immuables
? ou bien des races, transportées sous l'influence de circonstances
différentes, peuvent-elles, à la longue, s'écarter
du type originel, et constituer, à leur tour, des races ou espèces
distinctes par de nouveaux caractères ? »
Connaissances
au XIXe![]() Evolutionnisme
Evolutionnisme![]() Antiquité
Antiquité![]() Moyen
Age
Moyen
Age![]() Buffon
Buffon
![]() Erasmus
Darwin
Erasmus
Darwin![]() Geoffroy
Saint-Hilaire
Geoffroy
Saint-Hilaire![]() Lamarck
Lamarck![]() Transformisme
de Lamarck
Transformisme
de Lamarck
![]() Charles Darwin
Charles Darwin![]() l'Origine
des Espèces
l'Origine
des Espèces![]() Théorie
de l'évolution
Théorie
de l'évolution
![]() DÃĐveloppement de la génétique
DÃĐveloppement de la génétique![]() Néodarwinisme
Néodarwinisme![]() Classification
phylogénétique
Classification
phylogénétique
![]() Systématique
génétique
Systématique
génétique![]() Fixisme
Fixisme
- de Witt Hendrick C.D. - Histoire du développement et de la biologie - Volume, I, II, III - Presses polytechniques et universitaires romandes, Paris, 404, 460 et 635 p., 1992, 1993 et 1994
- Darwin on line
- Darwin Ch. - Voyage d'un naturaliste autour du monde - Maspero, Paris, 2 volumes, 251 et 299 p., 1982
- Rostand J. - Charles Darwin - Gallimard, Paris, 237 p., 1947
- Conry Y. - Darwin, théorie de l'évolution (textes choisis) - PUF, Paris, 233 p., 1981
- Thuillier P. - Darwin & C° - Editions Complexe, Bruxelles, 210 p., 1981
- Eibl-Eibesfeldt I. - Ethologie - Biologie du comportement - Naturalia et Biologica Editions scientifiques Paris, 576 p., 1972
- Campan R., Scapini F. - Ethologie, approche systémique du comportement - De Boeck Université, Bruxelles, 737 p., 2002
- Université d'Oxford - Dictionnaire du comportement animal - Robert Laffont, Paris, 1013 p., 1990
- Immelmann K. - Dictionnaire de l'éthologie - Pierre Mardaga Editeur, Liège, 296 p., 1990