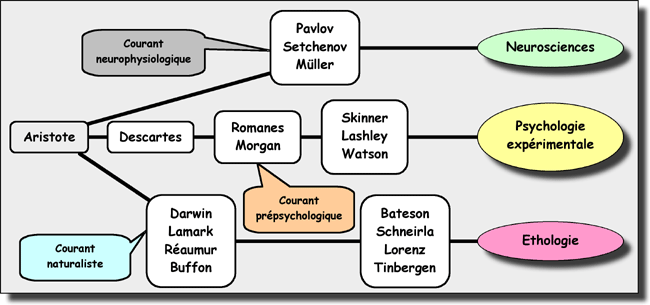Approche comportementale du vétérinaire comportementaliste
Behaviorisme et éthologie objective
Citation
« Il ne suffit pas de dire : je me suis trompé
; il faut dire comment on s'est trompé. »
Claude Bernard
![]()
La vision comportementale du vétérinaire comportementaliste
est dérivée de l'éthologie cognitive : elle est appelée
éthologie clinique.
Après un bref rappel des notions éthologiques), nous décrirons notre manière de travailler dans le cadre de nos cliniques.
Behaviorisme et psychologie expérimentale
Le behaviorisme est né d'une volonté d'abandonner toute forme de " mentalisme " et d'anthropomorphisme, et d'un souhait de se doter d'une méthodologie scientifique rigoureuse.
Pour cela et avant tout, la priorité est donnée à l'observable et au rejet de facultés jugées difficilement mesurables et susceptibles d'échapper à toute analyse : la conscience, l'intentionnalité, le raisonnement, la logique, les états mentaux, les représentations mentales.
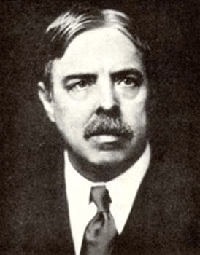 Le
behaviorisme a été profondément influencé par
le courant physiologique, et notamment les travaux issus des neurophysiologies
allemande (
Le
behaviorisme a été profondément influencé par
le courant physiologique, et notamment les travaux issus des neurophysiologies
allemande (![]() infos) et russe (
infos) et russe (![]() infos) qui étudièrent les réflexes (
infos) qui étudièrent les réflexes (![]() infos).
infos).
La quasi-totalité des travaux, menés en laboratoire par Edward Thorndike (1874-1949), John Broadus Watson (1878-1958) et surtout Burrhus Frédéric Skinner (1904-1990), sur un petit nombre d'espèces (rat essentiellement), mettent en jeu des stimuli parfaitement contrôlables, évoquant de manière constante des comportements dont la reproductibilité permet d'établir un certain nombre de lois.
![]()
Pour les behavioristes, tout comportement peut être défini
comme une réponse à un stimulus : l'animal ne se construit
que par apprentissage.
Les behavioristes ont recherché inlassablement les lois générales qui régissent cet apprentissage : ils ont exagéré son importance dans le développement du comportement animal et ont négligé la dimension phylogénétique, évolutive et adaptative des comportements.
![]()
Pour eux, seul l'environnement décide du comportement d'un individu
pendant son développement. En d'autres termes, tout comportement
ou presque est acquis.
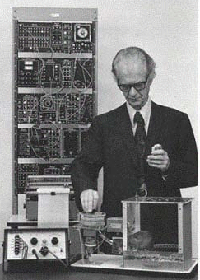 Les comportements pathologiques sont des comportements
" mal " appris et, volontairement ou non, par l'environnement
ou un entourage déficient.
Les comportements pathologiques sont des comportements
" mal " appris et, volontairement ou non, par l'environnement
ou un entourage déficient.
Chaque individu est unique : une sémiologie (partie de la médecine qui traite des signes cliniques et des symptômes des maladies) ou une nosographie (description et classification des maladies) est impossible.
Il suffit de modifier les facteurs de l'environnement pour modifier le comportement : une partie des animaux ne " répondant " pas à ces thérapies sont " anormaux " et, à la limite, devront être euthanasiés.
![]()
Dans notre discipline vétérinaire, l'école anglo-saxonne
a une approche purement behavioriste du comportement animal. Elle
ne reconnaît pas les états pathologiques (phobie,
anxiété,
dépression,
dysthymie).
Elle se limite à la recherche des éléments déclencheurs et renforçateurs des comportements qui ont provoqué la consultation comportementale.
Dans un tout autre registre, de nombreux éducateurs canins agissent de même.
Ethologie objective
Notion de comportement dans l'éthologie objective
Le cadre très artificiel des expériences
menées représente la principale critique de personnages issus
du courant naturaliste, zoologiste ou évolutionniste (![]() infos), qui s'intéressaient aux comportements des animaux.
infos), qui s'intéressaient aux comportements des animaux.
 En
réaction au Behaviorisme se développe alors l'éthologie
animée par des naturalistes comme Konrad
Lorenz (1903-1989), Nikolaas
Tinbergen (1907-1988) et Karl
Von Frisch (1886-1982) qui affirment que l'étude des comportements
des animaux doit se faire dans leur milieu de vie naturel par une observation
" passive " sans intervention des scientifiques.
En
réaction au Behaviorisme se développe alors l'éthologie
animée par des naturalistes comme Konrad
Lorenz (1903-1989), Nikolaas
Tinbergen (1907-1988) et Karl
Von Frisch (1886-1982) qui affirment que l'étude des comportements
des animaux doit se faire dans leur milieu de vie naturel par une observation
" passive " sans intervention des scientifiques.
- Ils découvrent les comportements innés des oiseaux.
- Ils reconnaissent que les séquences comportementales sont des unités fonctionnelles.
Elles comprennent plusieurs phases : ils distinguent
" l'acte final rigide, satisfaisant l'impulsion " (ou acte
consommatoire) et les comportements d'appétence, variables et préparatoires
par lesquels un animal recherche une situation stimulatrice déclenchante
déterminée (![]() infos).
infos).
- Ils découvrent le concept de développement comportemental et la notion d'empreinte.
 Lorenz
a montré que, si certains comportements étaient bien définis
dans leur séquence motrice, le stimulus déclencheur est souvent
non spécifique : les oisillons de l'oie cendrée, à
l'éclosion, suivent la première chose mobile qu'ils voient
(en général leur mère, mais, dans ce cas, Lorentz lui-même),
et le lien indéfectible créé durera toute leur vie.
L'éclosion constitue une période
sensible dans le développement de l'organisme.
Lorenz
a montré que, si certains comportements étaient bien définis
dans leur séquence motrice, le stimulus déclencheur est souvent
non spécifique : les oisillons de l'oie cendrée, à
l'éclosion, suivent la première chose mobile qu'ils voient
(en général leur mère, mais, dans ce cas, Lorentz lui-même),
et le lien indéfectible créé durera toute leur vie.
L'éclosion constitue une période
sensible dans le développement de l'organisme.
Contre le behaviorisme, les éthologistes ont reconnu la spontanéité des mouvements instinctifs, comme une particularité physiologique de grande importance qui a échappé aux recherches des réflexologistes classiques.
Konrad
Lorenz (1903-1989) cherchera les modes d'intégration
de l'inné et de l'acquis en donnant une importance particulière
à cette disposition innée à l'apprentissage, dont il
a constamment souligné l'importance pour les sciences humaines, ce
qui lui vaudra avec Nikolaas
Tinbergen (1907-1988) et Karl
Von Frisch (1886-1982) le prix Nobel de médecine (1973). De cette
opposition entre l'éthologie et le behaviorisme naît la querelle
aujourd'hui obsolète entre l'inné et l'acquis (![]() infos).
infos).
![]()
Pour ces scientifiques, la génétique influence fortement les
comportements.
 Les comportements pathologiques sont des comportements produits par des
animaux dont la capacité d'adaptation est dépassée.
Les comportements pathologiques sont des comportements produits par des
animaux dont la capacité d'adaptation est dépassée.
Une sélection génétique rigoureuse permettra de ne pas reproduire les mêmes caractères.
- Dans cette optique, la société centrale canine nous offre une image singulière des races, en leur accordant telle ou telle particularité comportementale, comme " aimant les enfants " par exemple.
- Une autre conséquence de cette vision des choses est la promulgation
des lois sur les chiens dangereux faisant porter le chapeau à
telle ou telle race (" délit de sale gueule ")
pour appréhender le " mal des banlieues " (
 infos).
infos).
Questionnement de Tinbergen
Ethologie cognitive
Notion
de comportement![]() Behaviorisme
Behaviorisme![]() Ethologie
objective
Ethologie
objective
![]() Questionnement
de Tinbergen
Questionnement
de Tinbergen![]() Ethologie
cognitive
Ethologie
cognitive![]() Comportement
normal
Comportement
normal
![]() Homéostasie
Homéostasie![]() Etat
réactionnel
Etat
réactionnel![]() Séquence
comportementale
Séquence
comportementale
![]() Comportement
pathologique
Comportement
pathologique![]() Consultation
comportementale
Consultation
comportementale
- Université d'Oxford - Dictionnaire du comportement animal - Robert Laffont, Paris, 1013 p., 1990
- Immelmann K. - Dictionnaire de l'éthologie - Pierre Mardaga Editeur, Liège, 296 p., 1990
- Pageat P. - Pathologie du comportement du chien, Editions du Point Vétérinaire, Maisons-Alfort, 384 p., 1998
- Gheusi G. - La cognition animale - 3ème cycle professionnel des écoles nationales vétérinaires - Toulouse 2000
- Gaultier E - Les différentes approches du comportement - 3ème cycle professionnel des écoles nationales vétérinaires - Toulouse 2000