Système somatosensoriel (somesthésie)
Douleur et nociception : rôle de la substance P
Citation
« La douleur. Elle est patiente, mais quand elle
vient c'est pour longtemps, ne la méprise pas. »
André Majo
![]()
La substance P est un neurotransmetteur particulièrement actif dans
la nociception et les phénomènes inflammatoires.
Le potentiel d'action, créé dans la fibre neuronale,
est transmis, par transport axonal antérograde (" normal "),
dans les voies nociceptives vers le cerveau (![]() infos).
infos).
![]()
La substance P, synthétisée
dans les corps cellulaires des neurones des fibres sensorielles Aγ et
C, est libérée au niveau central (avec le glutamate)
pour transmettre les influx nociceptifs.
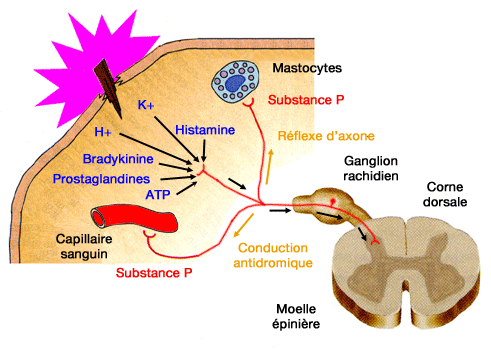 En outre, il existe, ce que l'on nomme, un réflexe d'axone, ou mieux
dendritique : le transport est cette fois, centrifuge, dans le sens opposé
à la normale (conduction antidromique).
En outre, il existe, ce que l'on nomme, un réflexe d'axone, ou mieux
dendritique : le transport est cette fois, centrifuge, dans le sens opposé
à la normale (conduction antidromique).
Cela peut s'expliquer facilement par la morphologie des
neurones nociceptifs qui sont bipolaires : on considère que l'axone
est la fibre qui part du ganglion rachidien (![]() infos) vers la moelle, alors que l'autre fibre correspond à des
dendrites où la transmission peut s'effectuer dans les deux sens.
infos) vers la moelle, alors que l'autre fibre correspond à des
dendrites où la transmission peut s'effectuer dans les deux sens.
La stimulation du nocicepteur gagne la musculature des artérioles adjacentes par conduction antidromique pour libérer, dans les régions proches, la substance P (SP), le CGRP (peptide lié au gène de la calcitonine) et la neurokinine A qui renforceraient l'effet vasodilatateur.
La substance P est une molécule de 11 acides aminés qu'on préparait sous forme de " poudre ", d'où son nom. Le CGRP est également une neurokinine (ou tachykinine).
- La SP et les autres neurokinines sont largement représentées
dans les aires de la formation réticulée (aire périaqueducale,
aire parabrachiale - (
 infos) - qui projettent sur le système limbique (
infos) - qui projettent sur le système limbique ( infos) dont le rôle n'est plus à démontrer dans
les régulations émotionnelles.
infos) dont le rôle n'est plus à démontrer dans
les régulations émotionnelles. - En outre, elles se retrouvent dans les régions monoaminergiques (noyaux du raphé, locus coeruleus…) qui régulent le comportement et l'humeur.
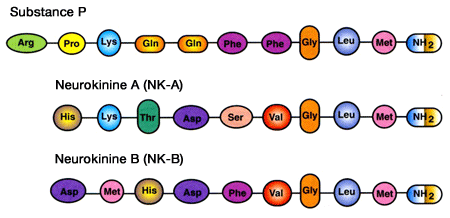 D'autres neurotransmetteurs (somatostatine,
peptide
lié au gène de la calcitonine (CGRP), cholécystokinine
(CKK), peptide
vasoactif (VIP), galanine…)
joueraient également un rôle, mais plutôt de neuromodulateurs,
c'est-à-dire qu'ils modulent les effets excitateurs ou inhibiteurs
de neurotransmetteurs plus classiques.
D'autres neurotransmetteurs (somatostatine,
peptide
lié au gène de la calcitonine (CGRP), cholécystokinine
(CKK), peptide
vasoactif (VIP), galanine…)
joueraient également un rôle, mais plutôt de neuromodulateurs,
c'est-à-dire qu'ils modulent les effets excitateurs ou inhibiteurs
de neurotransmetteurs plus classiques.
La substance P (SP), outre son rôle de neurotransmetteur central, provoque, au niveau périphérique :
- une vasodilation directe, une extravasation plasmatique et un oedème,
- la dégranulation des mastocytes avec sécrétion d'histamine, ce qui amplifie la vosodilatation et la formation de prostaglandines au niveau local.
![]()
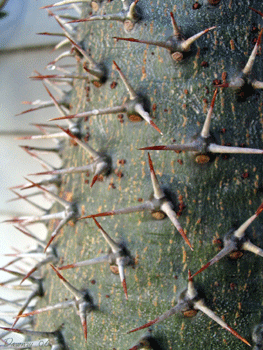 On appelle ce phénomène : inflammation neurogène (réflexe
d'axone) à l'origine de l'extension de l'inflammation.
On appelle ce phénomène : inflammation neurogène (réflexe
d'axone) à l'origine de l'extension de l'inflammation.
Ces substances algogènes excitent encore plus les dendrites qui libèrent davantage de SP pour stimuler les dendrites proches : les nocicepteurs sont plus réactifs (sensibilisés) et la réaction douloureuse s'étend pour protéger la zone afin de la préserver d’une autre atteinte.
Toutes ses réactions sont également modulées
par le système sympathique (![]() infos) qui sécrète de l'adrénaline (
infos) qui sécrète de l'adrénaline (![]() infos) dont l'ATP (
infos) dont l'ATP (![]() infos) est un coneurotransmetteur.
infos) est un coneurotransmetteur.
![]()
Tous ces phénomènes amplifient la douleur (hyperalgie) : quand
on touche une lésion, les nocicepteurs sensibilisés peuvent
nous faire hurler de douleur !
C'est également un supplice chinois de choix : faites tomber une goutte d'eau au même endroit pendant des heures rend " fou ".
![]()
Tout cela explique les signes de l'inflammation : rougeur, douleur, chaleur
et tuméfaction (rubor, dolor, calor et tumor).
Somesthésie![]() Douleur
et nociception
Douleur
et nociception![]() Nocicepteurs
Nocicepteurs![]() Transduction
nociceptive
Transduction
nociceptive
![]() Fibres
nociceptives
Fibres
nociceptives![]() Voies
nociceptives
Voies
nociceptives![]() Contrôle
douleur
Contrôle
douleur
![]() Douleur et comportement
Douleur et comportement![]() Grille d'ÃĐvaluation de la douleur
Grille d'ÃĐvaluation de la douleur
![]() Toucher
Toucher![]() Thermoception
Thermoception![]() Proprioception
Proprioception
- Pritchard T.-C., Alloway K.-D. - Neurosciences médicales - De Boeck Université, Bruxelles, 526 p., 2002
- Bossy J. - Anatomie clinique - Springer-Verlag, Paris, 475 p., 1990
- Nadeau E. - Neurosciences médicales - Elsevier, Issy-les-Moulineaux, 569 p., 2006
- Le Bars D. - Physiologie de la douleur - PMCAC, mars-avril n°2, mai-juin n°3, 1998
- Gogny M. - Douleur et traitement de la douleur - Point vétérinaire, vol 24, n° 149, 1993
- Stahl S. M. - Psychopharmacologie essentielle - Médecine-Sciences, Flammarion, Paris, 640 p., 2002
- Felten D.-L., Jozefowicz R.-F. - Atlas de neurosciences de Netter - Masson, Paris, 306 p., 2006
- Marieb E. N. - Anatomie et physiologie humaines - De Boeck Université, Saint-Laurent, 1054 p., 1993
- Rosenzweig M.R., Leiman A.L., Breedlove S.M. - Psychobiologie - DeBoeck Université, Bruxelles, 849 p., 1998
- Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D., Katz L.C., Lamantia A-S, McNamara J.O., Williams S.M. - Neurosciences - De Boeck, 800 p., 2003
- Kolb B., Whishaw I. - Cerveau et comportement - De Boeck Université, Bruxelles, 1013 p., 2008
- Bear M.F., Connors B.W., Paradiso M.A. - Neurosciences : à la découverte du cerveau - Editions Pradel, 881 p, 2007